Sommaire
Comme la linguistique structurale, qui met de côté la richesse sonore de la parole pour faire advenir l’élégante simplicité du système des phonèmes et se détourne du monde foisonnant des choses au profit de l’espace articulé du signifié, la théorie de la génétique textuelle s’est construite sur un certain nombre de renoncements. À en croire l’article fondateur1 de Jean Bellemin‑Noël, « Reproduire le manuscrit, présenter les brouillons, établir un avant‑texte », le généticien délaisse la matérialité du document de genèse, abandonné aux « manuscriptologues », pour reproduire la simple image du manuscrit. Il extrait de ce manuscrit, comme on extrait un diamant de sa « gangue » (p. 12), le brouillon, défini comme « un ensemble de signes […] au sens strict, excluant ce qu’on nomme les indices, qui produisent de la signification de manière involontaire et hors système (entendons ce système restreint que constitue la préparation d’un ouvrage précis) » (p. 11). Il « élague » les « déchets » que constituent « renseignements extra‑textuels », « indications de scription », « commentaires portant sur le texte » et « notes de régie » pour arriver au « texte pur » du brouillon. Enfin il construit un avant‑texte à partir de ce brouillon, avec la partialité revendiquée d’un point de vue critique nécessairement sélectif. En amont de tout cela, une exclusion supplémentaire est prononcée avec une fermeté mêlée d’embarras : celle de l’auteur.
S’il était sans doute historiquement nécessaire de s’appuyer sur les acquis de la linguistique du signe pour faire avancer la théorie génétique et de prendre modèle sur les renoncements qui fondaient la scientificité de cette discipline pilote2, la pratique des généticiens a été, de fait, beaucoup moins ascétique. Cette pratique a toujours fait fi de toute pureté sémiologique et n’a jamais cessé, en particulier, de s’appuyer sur les indices.
Nous nous proposons de montrer ici que ce recours aux indices est une partie essentielle de la discipline, l’ancrant solidement dans la matérialité du document tout en l’ouvrant sur la virtualité des possibles, lui conférant un caractère à la fois plus concret et plus abstrait que les autres approches du texte. Dirons‑nous qu’il en constitue la spécificité ? Certainement pas, car nous allons voir au contraire que ce trait place la génétique au sein d’un groupe de disciplines relativement nombreuses et très anciennes, voisinage qui n’est pas dépourvu de conséquences.
Si la génétique a besoin de se chercher un précurseur sur ce point, elle pourrait se réclamer d’une figure qui n’est pas moins illustre que Ferdinand de Saussure : Sigmund Freud lui‑même. Pour bien montrer qu’il s’agit ici de la génétique des textes en général, et non pas seulement de la critique génétique d’inspiration psychanalytique3, on prendra pour point de départ le texte de Freud qui est sans doute le plus éloigné de toute préoccupation psychanalytique directe : son article sur « Le Moïse de Michel‑Ange ». Rappelons que cette étude avait été publiée anonymement en 1914 dans la revue Imago, accompagnée d’une note indiquant qu’elle avait été retenue parce qu’elle témoignait d’une « manière de penser présentant quelque analogie avec la méthode de la psychanalyse »... Quant à nous, nous sommes fondés à reconnaître dans son propos une analogie certaine avec la génétique. Il y est question en effet de remonter d'une œuvre d’art, statique, par définition, puisqu’il s’agit d’une sculpture, et tout particulièrement de la « sainte et presque écrasante immobilité » du Moïse de marbre, à un mouvement préalable, de rompre l’unité et l’immédiateté de l’objet esthétique pour y déceler « une triple stratification » temporelle, et de retrouver au sein de l’œuvre, figée dans l'évidence rétrospective de son achèvement, au cœur du chef‑d’œuvre, prisonnier de sa perfection, les traces furtives d'un déséquilibre préalable.
Relever des traces, au double sens de marque involontaire4 et de vestige ténu, c’est bien ainsi qu’on pourrait décrire la méthode mise en œuvre. Freud lui‑même déclare s’être inspiré de la démarche de Giovanni Morelli, qui avait mis au point une procédure d’authentification des tableaux fondée sur les « choses inobservées que le copiste néglige », comme les ongles ou les cheveux, et donc « apparentée de très près à la technique de la psychanalyse. Elle aussi a coutume de deviner par des traits dédaignés ou inobservés, par le rebut (« refuse ») de l’observation, les choses secrètes ou cachées. » Il est à noter que le mot anglais auquel Freud éprouve le besoin de se référer entre parenthèses, s’il désigne étymologiquement ce qui a été refusé, renvoie couramment et très concrètement aux ordures. Morelli traquait le déchet au cœur même de l’objet esthétique, s’excusant ironiquement de s’occuper de choses aussi basses que les ongles ou les cheveux dans l’univers sublime de l’œuvre d’art. La génétique, par définition, s’intéresse aux résidus de la création, à ce qui a été effectivement mis au rebut par l’artiste (le brouillon, la version ébauchée, le mot raturé). La volonté de pureté et de formalisation sied donc mal au généticien qui est par essence un fouilleur de détritus (ses détracteurs, voire les auteurs eux‑mêmes5 ne se privent pas de le lui reprocher, souvent en termes plus malsonnants) et bien plus qu’au linguiste saussurien réduisant le langage à son abstraction essentielle, il s’apparente au chasseur qui examine les déjections d’une harde de chevreuils pour reconnaître leur nombre, leur âge, depuis combien de temps ils sont passés, et même d’où ils viennent à partir de ce dont ils se sont nourris, ou au médecin d’autrefois qui examinait attentivement les selles de son patient pour connaître l’état de ses entrailles ou qui goûtait les urines pour diagnostiquer un diabète.
Morelli, Freud interprète de Michel‑Ange, Freud psychanalyste, le médecin6, le chasseur et le critique génétique relèvent tous du même modèle épistémologique, caractérisé par un déplacement d’accent vers des détails considérés comme indignes d’attention ou tout à fait périphériques, ce qui se traduit par une promotion du « rebut » de l’observation, de la « gangue » des faits, et corrélativement par un même type d’opération sémiologique, le décryptage d’indices.
Ce modèle se distingue du paradigme physico‑mathématique qui tend à occuper le devant de la scène depuis Galilée, en ce qu’il s’appuie sur le qualitatif plus que sur le quantitatif et s’attache à reconnaître les singularités plutôt que les généralités7. Carlo Ginzburg l’a décrit, dans une remarquable étude, sous le nom de paradigme indiciaire8.
Parmi les autres « disciplines » appartenant à ce même paradigme, Ginzburg cite notamment, à côté de la paléontologie, la mantique, la physiognomonie, l’anthropométrie judiciaire...
La génétique y retrouve également sa sœur aînée la philologie, dont l’objet est le texte dans son individualité, mais Ginzburg fait remarquer qu’il s’agit d’un cas complexe, puisque l’histoire de la philologie se résume à une réduction constante des traits pertinents, à une épuration, à une dématérialisation du texte — les philologues eux‑mêmes considérant qu’ils n’ont atteint la scientificité qu’en sacrifiant l’emendatio, qui repose sur une appréciation qualitative, au profit de la recensio, purement mécanique.
Son objet s’est en effet constitué à travers une sélection drastique — destinée à se réduire par la suite — de traits pertinents […] On considéra tout d’abord comme non pertinents par rapport au texte tous les éléments qui étaient liés à l’oralité et à la gestualité. Puis, également, les éléments liés aux aspects physiques de l’écriture. Le résultat de cette double opération fut la progressive dématérialisation du texte, peu à peu épuré de toute référence sensible : même si un rapport sensible est nécessaire pour que le texte survive, le texte ne s’identifie pas à son support. Tout ceci nous semble aujourd’hui évident, alors que ce ne l’est pas du tout. Il suffit de penser à la fonction décisive de l’intonation dans les littératures orales, ou de la calligraphie dans la poésie chinoise…9
Nous voudrions suggérer que la génétique aurait beaucoup à perdre à suivre la philologie dans cette voie. L’avant‑texte n’est pas un texte et il n’est pas légitime de séparer les mots des brouillons de leurs supports, de leurs tracés et de leurs entours. Les uns et les autres ne sont que des indices (d’importance différente, il est vrai) qui permettent d’accéder indirectement à un objet, aussi concret mais aussi intangible que l’est pour l’astronome une lointaine galaxie : le processus d’écriture.
Au sein de ce paradigme figure aussi, de manière beaucoup plus centrale, l’ensemble des disciplines historiques (au nombre desquelles, bon gré mal gré, la génétique doit se compter pour tout un versant de son activité10). En effet, « l’histoire n’a jamais réussi à devenir une science galiléenne »11 car elle est « irrémédiablement liée au concret ». Sa perspective est délibérément individualisante12.
Même si l’historien ne peut pas ne pas se référer, de façon explicite ou implicite, à des séries de phénomènes comparables13, sa stratégie cognitive, comme ses codes d’expression, restent intrinsèquement attachés à l’individualisation (que l’individu soit un groupe social ou une société entière). En ce sens l’historien peut se comparer au médecin qui utilise les cadres nosographiques pour analyser la maladie spécifique du malade particulier. Comme celle du médecin, la connaissance historique est indirecte, indiciaire et conjecturale.
Mais au moins autant qu’à la médecine, l’histoire peut être rattachée à l’autre « discipline » exemplaire du paradigme indiciaire : la chasse, avec la lecture des traces que suppose la traque du gibier14. Ginzburg suggère même que le chasseur pourrait avoir été l’inventeur du récit, le premier narrateur, non pas parce qu’il serait un Tartarin invétéré, mais parce que le déchiffrement des indices jalonnant la piste d’un animal, ou même l’interprétation d’une empreinte unique (mais toujours nécessairement située dans un contexte et orientée), engendre tout naturellement un récit. Le chasseur aurait été, par nécessité professionnelle, le premier à savoir reconstituer une série cohérente d’événements, une description, non pas de ce qui est mais de ce qui a été. Il est bon que le généticien garde en mémoire cette lointaine filiation et n’oublie pas que la dimension narrative est une composante essentielle de sa propre activité15. Il y a d’ailleurs longtemps que les généticiens ont pris l’habitude de se comparer à ce chasseur des temps modernes qu’est le détective ou limier, Dupin ou Sherlock Holmes, dont la clairvoyance apparemment miraculeuse repose sur la réceptivité aux indices, et dont l’activité trouve son apothéose et son efficacité même dans la mise en récit de ces indices.
Ces différents rapprochements ne sont toutefois pas équivalents, sur le plan sémiotique au moins, car les deux « disciplines » ne relèvent pas du même type d’indice : la génétique a‑t‑elle affaire à des symptômes comme la médecine ou à des empreintes comme la chasse ?
Si l’on résume l’analyse que propose Umberto Eco, les différences principales sont au nombre de trois. L’empreinte et le symptôme sont l’une et l’autre dans un rapport de contiguïté à leur corrélat, mais l’empreinte présente de plus un rapport de ressemblance. Même si la notion de similitude pose de nombreux problèmes16 qu’il n’est pas question d’évoquer ici, on peut dire grossièrement que l’empreinte sur le sol ressemble au pied de l’animal, tandis que la pommette rouge ne ressemble pas à la pneumonie. Qu’en est‑il du matériau génétique ? Si l’on peut constater que l’œuvre ne ressemble souvent pas à sa genèse (ni à ses manuscrits)17, il est impossible de nier qu’il existe, à plusieurs niveaux, des rapports d’isomorphisme18 entre la genèse (le processus d’écriture) et les traces matérielles qui en subsistent (les manuscrits), bien que ces traces soient pour une très large part constituées de lettres et de mots, signes immotivés.
Deuxième critère de distinction: l’empreinte est généralement hétéromatérielle (elle est faite de sable et non pas de la chair de l’animal) alors que le symptôme est homomatériel, c’est‑à‑dire qu’il fait partie de la maladie, du tableau clinique. L’écrit fait‑il partie de l’écriture ? On peut hésiter pour savoir si l’œuvre fait partie de sa genèse, ou si elle en est coupée par une barrière absolue19 — soit qu’on la considère, dans une perspective hyper‑valérienne20, comme un sous‑produit, un peu accessoire, de la création, cendres refroidies après la flambée créative, marques sur la poussière de la scène quand le ballet est achevé, soit au contraire qu’on juge que l’objet esthétique achevé transcende ses origines pour exister dans une toute autre sphère —, mais il paraît impossible de dire que le manuscrit ne fait pas partie du processus d’écriture, à moins d’entretenir une conception tout à fait idéaliste de la genèse, qui verrait dans le manuscrit un support neutre, simple déversoir d’une production mentale se déployant sur une autre scène. Toute l’expérience de la génétique prouve au contraire que l’écriture interagit fortement avec son support.
Reste une troisième différence, qui tient au mode de contiguïté : le symptôme est généralement dans une contiguïté immédiate (synecdochique) à la maladie, tandis que l’empreinte (métonymique) témoigne d’un contact passé avec l’agent (l’empreinte ne devient visible qu’au moment où le pied s’est retiré). On pourrait donc dire que le symptôme indique une présence tandis que l’empreinte renvoie à une absence. De ce point de vue, le manuscrit, objet sémiotique décidément complexe, serait du côté de l’empreinte puisqu’il n’existe comme objet interprétable (du moins pour le généticien) qu’à partir du moment où le processus d’écriture dont il est le théâtre a pris fin.
Encore importe‑t‑il de distinguer cette absence de l’absence consubstantielle à tout signe ou à toute image, d’après la thématique largement développée notamment dans ses variantes mallarméennes, derridiennes, ou sartriennes. Barthes a très fortement insisté sur cette différence à propos d’une empreinte bien particulière : la photographie.
L’image, dit la phénoménologie, est un néant d’objet. Or, dans la Photographie, ce que je pose n’est pas seulement l’absence de l’objet ; c’est aussi d’un même mouvement, à égalité, que cet objet a bien existé et qu’il a été là où je le vois. C’est ici qu’est la folie ; car jusqu’à ce jour, aucune représentation ne pouvait m’assurer du passé de la chose, sinon par des relais ; mais avec la Photographie, ma certitude est immédiate : personne au monde ne peut me détromper. La Photographie devient alors pour moi un medium bizarre, une nouvelle forme d’hallucination : fausse au niveau de la perception, vraie au niveau du temps : une hallucination tempérée, en quelque sorte, modeste, partagée (d’un côté « ce n’est pas là », de l’autre « mais cela a bien été ») : image folle, frottée de réel. (La Chambre claire, p. 177)
Le privilège de la photographie est en fait moins absolu que ne le suggère Barthes. Si on revient à Eco et à son analyse, infiniment moins pathétique, de la sémiotique de l’empreinte, il prend comme exemple de « texte » engendré par une empreinte, la trace de pas unique que Robinson Crusoe découvre un beau jour sur son île censément déserte, texte qui pourrait être traduit en ces termes: « un homme est passé ici »21 — ce qui rejoint bien le Ça a été là qui frappe tant Barthes dans la photographie. On peut d’ailleurs remarquer au passage que chez Defoe, cette empreinte solitaire est le point de départ d’un bref épisode de délire qui s’empare tout à coup de Robinson, ébranlant pendant un temps son flegme britannique et les bases de l’univers bien ordonné qu’il avait su se construire — tandis que l’apparition de cannibales, en chair et en os, le laissera parfaitement calme et maître de lui‑même22.
On notera d’autre part que les termes très forts que Barthes emploie ici rejoignent ceux dont il s’était servi23 pour parler de l’énonciation : « ce gouffre ouvert à chaque mot, cette folie du langage [que nous] appelons scientifiquement : énonciation ». C’est qu’en effet l’énonciation est elle aussi une forme d’empreinte. Il y a là un paradoxe, puisque les indices en tant que tels n’ont pas d’énonciateurs : ils ne sont pas l’objet d’une production24, mais d’une reconnaissance. Néanmoins, les énoncés verbaux, qui font sens en aval comme des signaux, fonctionnent en amont comme des indices. C’est un processus d’abduction qui permet de remonter depuis les signaux linguistiques jusqu’à leur énonciation en les retournant et en les traitant en indices — de la même manière que la génétique prend à rebours le matériau langagier contenu dans les manuscrits pour remonter jusqu’aux processus d’écriture. Ce qui ne veut pas dire que les processus d’écriture se confondent avec l’énonciation : les deux notions se chevauchent partiellement sans se recouvrir.
Une autre empreinte va nous ramener tout près du matériau génétique. Sur certains des manuscrits de Balzac, on remarque des cercles brunâtres25 : ce sont les traces de sa fameuse tasse de café. C’est au moins aussi frappant qu’une photographie de Balzac, cela a la même force mediumnique, hallucinatoire, dont parlait Barthes. Or les traits de plume figurant à leur côté sur le manuscrit sont des empreintes, bien sûr infiniment plus complexes, mais dotées d’un pouvoir d’évocation comparable.
Si on rapporte leur statut à celui de la photographie, on s’aperçoit que les trois rôles que distingue Barthes à l’intérieur du processus photographique sont ici concentrés. « Balzac » est d’abord l’Operator : il prend une sorte de photographie du monde avec l’appareil qu’est son manuscrit ou plutôt son texte en devenir (et ce n’est pas parce qu’il est un écrivain “ réaliste ” — on pourrait dire la même chose d’un écrivain de science‑fiction, de Mallarmé ou de Hegel rédigeant sa Logique...26). Mais « Balzac » est aussi le Spectrum (le photographié), dans la mesure où la surface du papier enregistre une image— peut‑être même un film — de « lui » en état d’écriture, le travail du généticien consistant à révéler cette pellicule sensible, à développer ce film. Et enfin « Balzac » est aussi le Spectator, celui qui contemple la photographie, car le regard de l’écrivain sur son propre manuscrit s’incarne dans ses révisions et ses ratures27. À la première page de La Chambre claire, Barthes exprime son étonnement irréductible devant le portrait de Jérôme Bonaparte : « Je vois les yeux qui ont vu l’Empereur. » Le pouvoir du manuscrit est bien du même ordre : Balzac (ou Flaubert ou Joyce) a vu cette page. Mes yeux rencontrent les leurs sur le folio ; Balzac me regarde à travers ces ocelles que sont les cercles brunâtres — mais tout autant et même plus à travers chacune des lignes, chacune des ratures de son manuscrit.
On pourrait parler, en termes deleuziens, d’une « visagéité » du manuscrit, qui le polarise fortement. Mais il faut se garder d’autant plus des effets de capture imaginaire et ne pas céder à ce que Gombrich appelle, en histoire de l’art, la tentation physiognomonique28, c’est‑à‑dire, en l’occurrence, voir dans le manuscrit l’expression directe et transparente d’un individu.
On se souvient de la dénégation radicale de Valéry :29
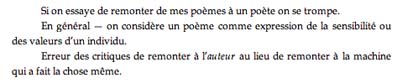
Cette « erreur » menace encore plus directement les généticiens qui risquent de se laisse aspirer dans une relation duelle de fascination liée à la présence/absence indicielle que nous venons de souligner.
On a souvent dit les limites de l’exercice qui consiste à s’interroger sur les motivations inexprimées d’un personnage de roman (qui n’est rien d’autre que la somme des mots qui le concernent à l’intérieur du roman), or on est obligé de considérer que l’auteur auquel nous avons affaire dans un dossier génétique n’est lui aussi, en pratique, qu’un être de papier. Nous savons qu’un être de chair a existé, mais rien ne nous permet de dire si celui qui se montrait à ses amis ou agissait dans sa vie privée était bien le même que celui qui écrivait, qui écrivait ce manuscrit‑là30. C’est ce postulat paresseux d’une continuité entre l’être social et l’écrivain, que dénonçait déjà Proust dans le Contre‑Sainte‑Beuve.
Quoi qu’il en soit, les techniques mises en œuvre par la fiction (focalisation externe, unreliable narrators) nous ont exercés à traiter avec circonspection des données telles que les déclarations d’un personnage (ou d’un auteur) sur ses propres motivations ou même les témoignages extérieurs et à nous fier plutôt aux indices indirects qui nous permettent d’inférer une telle motivation. Le problème est que le plus important indice est précisément ce qu’il s’agit de motiver (tel comportement du personnage, telle caractéristique de l’œuvre, et plus généralement, l’ensemble du comportement du personnage, l’œuvre elle‑même). Cette situation présente un risque évident de circularité. L’indétermination qui en résulte est un grand avantage pour la littérature, puisqu’elle permet de laisser à jamais ouvert le personnage, mais elle est un inconvénient grave pour une explication scientifique qui prétendrait s’appuyer sur un terrain aussi mouvant. On est obligé de se reposer sur la cohérence et la convergence des indices.
Mais que se passe‑t‑il si, pour des raisons esthétiques et/ou psychologiques, c’est l’incohérence qui est recherchée — par exemple dans tel « monologue intérieur » d’Ulysse ?31 On peut même aller plus loin, en considérant que tout acte de création est une certaine rupture par rapport aux cohérences préexistantes. Il est, en tant que tel, au moins partiellement imprévisible, déviant par rapport à son environnement, constituant un accident génétique, une catastrophe dans le processus d’écriture32.
C’est pourquoi nous en sommes réduits à interpréter nos indices à la lumière d’idées préconçues sur les principes d’explication vraisemblables et déterminants par rapport à d’autres. Il faut donc se garder d’hypostasier ce qui n’est qu’une reconstruction hypothétique, formulée à partir d’une représentation d’un « monde possible », c’est‑à‑dire à partir d’une « encyclopédie » comprenant notamment des indications sur la psychologie des écrivains, généralement établie sur une base consensuelle à l’intérieur d’une société donnée, mais éminemment variable dans le temps, ou, en d’autres termes, de stéréotypes psychologiques rapidement datés.
Cela ne signifie évidemment pas que les manuscrits ne peuvent pas fournir des matériaux aux sciences cognitives ou aux plus traditionnels des biographes (ces derniers n’ont d’ailleurs pas attendu notre permission), ni que l’empathie ne puisse pas être utile à certains stades d’investigation, mais elle conduit aussi à de grossières erreurs ou à de naïves simplifications.
S’il est certain que le manuscrit nous confronte à une subjectivité, cette subjectivité ne doit pas nécessairement être analysée en termes psychologiques, d’autres champs (théorie des jeux, des attentes rationnelles...) offrent l’exemple d’un traitement abstrait, logicisé, du sujet. Il est vrai que ces disciplines s’appuient souvent sur une conception plutôt simpliste d’un sujet unitaire33. En tout cas, il vaudrait toujours mieux formuler les résultats en termes de ce que Popper appelle des « situations de problèmes » et distinguer, au moins théoriquement, Balzac et « Balzac », l’individu et la machine valérienne, c’est‑à‑dire le processus d’écriture à l’œuvre dans l’avant‑texte.
Un jour un jeune homme vint vers Joyce pour lui demander la permission de baiser la main qui avait écrit Ulysse. Joyce le lui déconseilla sous prétexte que cette main avait fait aussi bien d’autres choses34. Par delà les implications salaces ou scatologiques qu’affectionnait Joyce, il faut y voir une mise en garde contre les dangers de la métonymie et les promiscuités qu’elle entraîne.
Souligner ce danger n’est pas réintroduire par un autre biais l’exigence de pureté méthodologique, le désir de dépouillement de la gangue que nous avions mis en cause et déclaré incompatible avec les fondements mêmes de la démarche génétique. D’une part, il est certain que le glissement métonymique ne pourra jamais être contrôlé, il est inévitablement impur — puisqu’il est la source même de l’impureté. D’autre part, aucun indice n’est à rejeter, d’où qu’il provienne, événement biographique, tendance ou pulsion dont on pourrait trouver la trace dans des documents extérieurs aux manuscrits, mais il convient de garder en mémoire qu’il s’agit d’indices, et que la validité de ces indices doit être appréciée dans un contexte d’écriture particulier.
Après avoir décrit sommairement le paradigme au sein duquel prend place la génétique textuelle et examiné quelques‑unes des implications — richesses et dangers — de cette appartenance, on consacrera la fin de cet article à esquisser une des voies dont on peut espérer qu’elle permettra d’avancer vers la formalisation souple qui apparaît nécessaire pour encadrer la prolifération indicielle engendrée par le matériau génétique. Il s’agit également de poursuivre un peu plus loin la réflexion sur le statut étrange de l’objet de la génétique des textes, qui déborde de toute part la littéralité textuelle, à la fois enraciné dans la matérialité de son support au sens large du terme, et inséparable des univers virtuels qu’il engendre.
L’expression de « monde possible » a été utilisée tout à l’heure au sens où elle est parfois employée en psychologie de la perception, quand on considère que le sujet formule des hypothèses à partir des données brutes de la perception en fonction de son attente concernant les différents mondes possibles qui peuvent être à l’origine de cette perception, à partir des indices fournis par la perception. Mais cette même expression est couramment employée, avec un sens apparenté et néanmoins différent, dans un tout autre champ : celui de la logique modale et de la sémantique des mondes possibles. Il a été abondamment montré que cette notion ne pouvait pas être transposée telle quelle dans le domaine littéraire, mais diverses tentatives ont été faites pour l’importer de manière non‑rigoureuse, ne serait‑ce que comme une analogie suggestive35. Il apparaît que cette importation pourrait être particulièrement appropriée et féconde dans le domaine de la génétique où elle n’a jamais, semble‑t‑il, été tentée. Rappelons que la logique modale évalue la vérité de propositions non pas dans le monde tel qu’il est, mais dans un ou plusieurs univers hypothétiques, ou, pour dire les choses autrement, étudie des propositions contrefactuelles et les univers engendrés par ces propositions pour analyser à leur lumière les notions de nécessité et de possibilité logiques36.
On pourrait par exemple essayer de réintroduire dans ce cadre, en termes d’attitudes propositionnelles, l’intériorité de l’écrivain, ou du moins ce qui en elle intéresse strictement la génétique : ce que l’écrivain croit que l’œuvre est ou va être, par opposition à ce qu’elle est ou va être réellement, constitue un univers qu’on peut étudier comme un monde possible. Mais les difficultés soulevées ci‑dessus ne disparaissent pas pour autant. En effet il faudrait en toute rigueur parler de ce que nous croyons que croit l’écrivain...
En revanche, il paraît relativement simple (et peu original) d’admettre que les manuscrits sont des matrices qui engendrent des mondes possibles (les œuvres virtuelles qu’ils esquissent). En logique, on appelle d’ailleurs parfois « livres » de tels ensembles matriciels de propositions37. L’avantage de cette conception serait de nous donner les moyens d’analyser et de comparer ces univers et leurs propriétés sur un mode plus systématique.
Il sera par exemple intéressant de s’interroger sur ce que peuvent être, dans ces différents mondes, les propriétés « nécessaires », « structurellement nécessaires » (c’est‑à‑dire réciproquement liées), et les propriétés « accidentelles ». Peut‑être serait‑on amené à considérer que, dans une perspective génétique, toutes les propriétés deviennent structurellement nécessaires, comme les pièces du jeu d’échec sont structurellement liées les unes aux autres dans le cours d’une partie.
On pourra par ailleurs s’interroger sur la nature des « individus » qui meublent ces univers « gravides » que sont les différentes versions, et sur leur identité à travers ces versions : un « individu » étant défini comme un ensemble de propriétés, est‑il licite de considérer que la Madame Bovary qui, dans les premiers scénarios de Flaubert, a pour nom de jeune fille Lestiboudois38 est la même que celle qui s’appellera (se sera appelée...) Rouault ?39
Dans un tel cadre, on peut également espérer mieux comprendre, ou du moins mieux formuler sur une base logique, les transformations qui mènent de l’un de ces univers à l’autre (d’une version à la suivante). S’agit‑il d’une simple explicitation de propriétés qui étaient implicites dans la première description ? Ou bien s’agit‑il d’une levée des ambiguïtés qui tiennent à la formulation, imprécise ou trop succincte, de la matrice ? Ou enfin s’agit‑il du passage d’un univers à un autre univers logiquement incompatible ? A première vue, ce dernier cas est nettement plus rare que les autres — et si cette impression est justifiée, cela confirmera que la majorité des faits d’écriture peuvent être analysés comme des faits de lecture. En effet, nous retrouvons, au cœur même de la genèse de l’œuvre, un processus d’abduction comparable, jusqu’à un certain point, à celui qui rend possible le déchiffrement des indices. Les phases d’invention sont entrecoupées par un travail d’analyse et d’inférence : le monde possible engendré par le déjà‑écrit autorise ou interdit tel ou tel développement, et la transgression représentée par l’invention prend plus souvent la forme d’une réinterprétation sur de nouvelles bases que d’une modification radicale des données. Ainsi Flaubert se disait « tourmenté par [sa] bosse de la causalité »40 et ses manuscrits montrent en effet que la plus grande part de son travail consiste à approfondir des données très tôt mises en place en explicitant leurs implications et leurs présupposés, ou, pour reprendre en la détournant un peu une des injonctions qu’il s’adressait à lui‑même, « poser [les] antécédents dans le cours des développements postérieurs »41.
Dans la notion de monde possible appliquée à la genèse du texte, il y a quelques ambiguïtés, qu’il n’est pas possible de lever dans cette première approche, mais qu’on mentionnera, ne serait‑ce que pour pouvoir les exploiter à bon escient.
Ainsi, les mondes possibles dont nous parlons sont‑ils des mondes textuels ou des mondes diégétiques ? Voulons‑nous comparer les univers sémantiques engendrés par les différents états du texte ou les univers formels, c’est‑à‑dire les différentes configurations textuelles possibles ? Dans le premier cas, il s’agirait de comparer un monde où le deuxième amant de Madame Bovary est un ancien officier de spahis, comme dans le premier « scénario général » rédigé par Flaubert, à un autre où il n’est que rentier.Dans le deuxième cas, il s’agirait de comparer une œuvre (esquissée par le même premier folio scénarique42) qui commencerait quand Charles Bovary est officier de santé à trente‑trois ans, à celle, bien connue, qui commence quand il entre au collège à quinze ans.
Sous réserve d’une plus ample exploration de la question, il n’est guère possible de faire une distinction nette entre les deux. Il est vrai qu’on peut considérer que l’univers représenté possède une certaine indépendance par rapport au matériau verbal qui l’engendre, dans la mesure où il resterait identique quand sont supprimées de sa description (il vaudrait mieux dire de sa prescription) certaines phrases non‑essentielles ou redondantes, ou bien quand est modifiée la technique de narration, voire même si une transposition est établie du texte au dessin (par exemple chez Delacroix) ou du texte au cinéma (par exemple chez Giono), à condition que cette transposition soit excessivement fidèle. Mais une telle position peut être réfutée précisément par excès — on peut à la rigueur s’assurer que tous les éléments prescrits par le texte figurent dans l’adaptation picturale ou cinématographique, mais il y aura nécessairement des éléments en trop, des propriétés en plus... On ne peut donc considérer qu’il s’agit du même univers.
Empruntons un exemple assez simple aux carnets de Crime et Châtiment. Pendant toute une phase, Dostoievski hésite entre deux partis pris narratifs. Il pose donc une alternative : « Si c’est une confession... » / « Si c’est un journal »43, chaque cas de figure étant suivi d’un certain nombre de recommandations. Il s’agit évidemment d’une différence fondamentale dans l’organisation formelle de l’œuvre : Raskolnikov rédige‑t‑il un journal au fur et à mesure des événements, ou bien va‑t‑il rédiger une confession a posteriori ? Or cette différence narrative implique une inévitable différence diégétique. Le statut diégétique du temps consacré à l’écriture, intervenant en alternance avec l’action ou à son issue, est passé sous silence, mais une autre différence induite est mise en évidence puisque elle entraîne d’emblée une modification dans la topographie de l’univers représenté et trouve sa répercussion dans le manuscrit, dès la formulation initiale du projet formel, qui se présente ainsi :
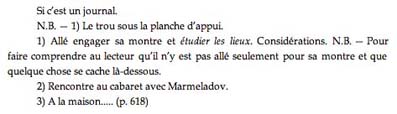
Le premier élément du plan, ou plus exactement le premier avant le premier, puisqu’un « 1) » vient s’ajouter sous forme de Nota Bene en amont de l’autre « 1) », est un petit supplément de diégèse rendu nécessaire par la forme narrative adoptée et qui se trouve explicité plus loin :
On ne trouvera jamais ces feuilles chez moi. La planche d’appui de ma fenêtre se déplace et personne ne le sait. Elle se déplace depuis trois mois, il y a beau temps que je le savais. En cas de besoin on peut la soulever et la remettre en place de telle façon que si un autre y touchait elle ne céderait pas. D’ailleurs, personne n’y songerait. C’est là, sous l’appui, que j’ai tout caché. J’ai enlevé deux briques... (p. 632)
On voit qu’une simple question formelle engendre un canton du monde fictif, réduit, mais spatialement bien défini, nécessaire pour ranger le volume du journal. A l’inverse la matérialité textuelle de l’œuvre est évidemment altérée ou bouleversée par le moindre ajout à l’univers représenté. C’est pourquoi il faut sans doute considérer que les différentes versions, même très proches, renvoient toujours à des mondes différents et conclure provisoirement que les deux types d’univers possibles (formels et diégétiques) sont si étroitement liés qu’il apparaît difficile de les distinguer, dans le cadre d’une théorie génétique plus encore que dans celui d’une théorie de la fiction.
Autre ambiguïté : les manuscrits nous présentent à la fois — et inséparablement — l’évolution d’un même monde, celui de l’œuvre en cours, et une succession de mondes possibles autonomes (les œuvres virtuelles). Mais cette autonomie est relative, car ce sont des mondes incomplets, qui se greffent l’un sur l’autre et qui gravitent même, du point de vue du généticien, autour du monde de l’œuvre finale dont ils tirent paradoxalement leur substance. Cette situation de dépendance doit pouvoir s’analyser sans trop de difficulté, car elle est du même ordre que celle qui rattache tous les mondes possibles au monde réel (parce que les univers postulés sont nécessairement incomplètement décrits, nous les superposons, pour tout ce qui n’est pas spécifié, au monde réel).
Enfin, on peut se demander s’il est légitime de parler de mondes possibles alors que le généticien a affaire à des objets bien palpables. Il est vrai que ce qui est effectivement disponible pour la comparaison, ce sont des brouillons, ou des versions textuelles tout à fait réels et non pas d’hypothétiques univers. Les différents états du texte n’ont rien de virtuels, ils existent, ils sont publiables — mais ce que le généticien, par opposition au philologue, vise à travers eux ce sont précisément des mondes possibles, c’est‑à‑dire les œuvres virtuelles qu’ils « contiennent ». C’est aussi sur ce point qu’apparaît la différence entre le généticien et l’historien. Comme le remarque Paul Veyne :
l'histoire est pleine de possibilités avortées, d'événements qui n'ont pas eu lieu ; nul ne sera historien s'il ne sent pas, autour de l'histoire qui s'est réellement produite, une multitude indéfinie d'histoires compossibles, de « choses qui pouvaient être autrement »44.
Mais le généticien, lui, peut faire plus que sentir ces possibilités, il peut observer et comparer certaines d’entre elles puisqu’elles sont partiellement incarnées dans les versions dont il dispose matériellement.
On serait malgré tout tenté de poser des degrés différents d’existence et d’établir une hiérarchie entre ce qui prend la forme d’un scénario de trois lignes, voire même d’une simple injonction (V. Woolf : « raconter une histoire qui juxtaposerait la folie et la raison », Stendhal : « raconter l’histoire de ma vie ») et un brouillon de trois cent pages qui développe ce projet embryonnaire ou une mise au net qui ne diffère du texte achevé que par quelques détails. Mais il faut se persuader du fait qu’aucun de ces avant‑textes n’existe en tant que texte au sens plein, c’est‑à‑dire comme œuvre autonome (même si rien n’interdit à un éditeur ou à un lecteur de les traiter comme un texte et de les apprécier comme tel). Ils ne sont que des matrices de textes, y compris quand ils ressemblent, à un infime détail près, au texte final ; ils ne sont que des matrices visant à engendrer un univers textuel qui demeure donc virtuel tant qu’il n’est pas actualisé par le bon à tirer. À cet égard, il n’y a pas de différence entre les éléments textuels et méta‑textuels, indications graphiques ou notes de régie. C’est toute la distinction que pose Bellemin‑Noël entre ce qui, dans les brouillons, relève du publiable et de l’impubliable qui est remise en cause dans cette perspective:
On peut caractériser rapidement l'impubliable et le publiable en donnant au premier une valeur absolue, marquant ce qui a priori jamais n'aura à être connu d'autrui, et au second la valeur encore hypothétique, et plus complexe, de ce qui est susceptible d'être édité si cela se maintient jusqu'à l'achèvement du travail. L'exemple de l'impubliable ce sera la notule opérationnelle que le rédacteur ne destine qu'à soi seul : scénario ou dossier documentaire ; publiable est au contraire tout segment écrit que l'écrivain traite durant l'élaboration comme autre chose qu'une notice privée, soit virtuellement du texte : ce qui est jeté sur le papier est par provision définitif, en tout cas ce n'est jamais à l'avance et par destination conçu comme un déchet ; et même le « premier jet », s'il est voué à se trouver amendé, a des chances de rester en l'état. C'est toujours après coup qu'on reconnaît un fourvoiement, une impasse, un échec. L'inabouti a d'abord été, fût‑ce l'espace d'un instant, du provisoirement abouti.45
On peut soutenir au contraire que ce qui est jeté sur le papier de brouillon est toujours définitivement provisoire. C'est seulement après coup qu'on reconnaît que quelque chose était le premier jet de quelque chose qui est devenu définitif. Rien n’est « virtuellement du texte » ou plutôt tout l’est puisque nous n’avons jamais dans les manuscrits que du méta‑texte, ou si l’on veut que du scénario en vue de la réalisation d’un texte final46 qui reste en suspens, virtuel, jusqu’au dernier instant.
En attendant d’explorer ces pistes, trop rapidement indiquées, on retiendra de ce parcours deux certitudes apparentées, qui peuvent s’exprimer d’abord sous une forme négative.
Non, la génétique ne peut se détourner de la matérialité du manuscrit, ni épurer le foisonnement du brouillon dans l’espoir de se constituer un objet idéal débarrassé de sa « gangue » — mais son objet n’est pas lui même un objet tangible, puisqu’il s’agit d’un processus dont les différentes étapes sont incomplètement incarnées par des vestiges textuels. Inséparable à la fois des documents matériels à travers lesquels il se laisse appréhender, sur le mode de la présence‑absence, et des univers virtuels successifs qu’il projette au fur et à mesure de son déroulement, cet objet a un mode d’existence très singulier.
Non, la génétique ne peut avoir pour visée principale la production de lois de portée générale, car elle est vouée au singulier — ce qui ne veut pas dire, tout au contraire, qu’elle soit condamnée à l’imprécision, à l’impressionnisme ou à la dispersion, moins encore au psychologisme. Au sein d’une constellation de disciplines apparentées qui prennent en compte les phénomènes dans leurs particularités, elle est la seule à être doublement tributaire, en amont et en aval, d’un régime sémiotique qui exclut la généralité. En effet, non seulement le généticien a recours, pour accéder à son objet, à des signes (comparables à des empreintes) dépourvus de types expressifs préformés47, traduisant donc un contenu pris dans son individualité, mais ce contenu (l’objet du généticien, donc) est lui‑même un processus d’invention, consistant à établir une corrélation qui sera nécessairement unique48 entre une forme et un contenu, sans que ce contenu préexiste à la forme qui va le déterminer en le représentant.
1 Fondateur en ce qu’il reprend, complète et systématise les notions posées dans Le Texte et l’avant‑texte (Paris, Larousse, 1972), ouvrage qu’on pourrait qualifier d’inaugural, et parce qu’il fait un tour d’horizon des problèmes soulevés par la génétique avec une ampleur de vue et une clarté inégalées. Les objections présentées ici ne visent à rien d’autre qu’à entretenir le dialogue appelé de ses vœux par Jean Bellemin‑Noël lui‑même dans cet article (« Débattre — se débattre — en public me paraît la seule chance d’avancer. », « Reproduire le manuscrit, présenter les brouillons, établir un avant‑texte », Littérature 28, 1977, p. 10.). On remarquera que Bellemin‑Noël est le premier à s’interroger, avec beaucoup de lucidité, sur la justification de « cet idéal de « pureté du texte » sous‑jacent au prélèvement de ce que nous avons baptisé, peut‑être à la légère, le brouillon », p. 16.
2 Mais la vieille philologie avait elle aussi pris son essor à partir d’un renoncement à la matérialité du texte, nous y reviendrons plus loin. Il est probable qu’elle a joué, de ce point de vue, le rôle d’un modèle plus ou moins conscient, pour la théorie génétique aussi bien d’ailleurs que pour la linguistique structurale.
3 À ce propos, notons simplement qu’il ne va pas tout à fait de soi de faire, comme Bellemin‑Noël, appel à l’Inconscient pour l’interprétation de l’avant‑texte après avoir exclu les significations involontaires au stade de l’établissement du brouillon.
4 Dans le “ Moïse ”, les marques sont involontaires de la part du personnage, mais sans doute pas de la part de l’artiste. Si l’on comprend bien Freud, Michel‑Ange nous incite à décrypter des indices qu’il a délibérément composés, nous incitant implicitement à prêter attention à des détails marginaux, comme le mouvement de la pilosité, ou la position (la mise en page, en quelque sorte) des tables de la loi, neutralisant la lettre de l’inscription divine.
5 Voir le terrible portrait du critique fouilleur de poubelle esquissé par William Golding dans son roman Paper Men.
6 Il s’agit de la médecine hippocratique, mais aussi de la nôtre, dans la mesure où elle continue à s’intéresser à l’individualité du cas et où elle ne se laisse pas emporter par la structure technico‑scientifique à laquelle elle fait nécessairement appel et qui appartient, elle, au paradigme physico‑mathématique dominant.
7 Ce n’est pas exactement la mathesis singularis appelée de ses vœux par Barthes dans la Chambre claire (Paris, Cahiers du Cinéma/Gallimard/Seuil, 1982, p. 21), à propos, nous allons y revenir, d’une certaine forme d’empreinte. En effet, cette connaissance de la singularité de l’objet ne s’appuie pas sur la subjectivité irréductible de l’observateur, mais souvent au contraire sur un savoir traditionnel accumulé par les générations.
8 « Traces : Racines d’un paradigme indiciaire », Mythes, Emblèmes, Traces, ‑ Morphologie et histoire, Paris, Flammarion, 1989.
9 « Traces », p. 154‑155.
10 Comme l’a bien noté Michael Werner dans « Genèse et histoire. Quelques remarques sur la dimension historique de la démarche génétique » in Leçons d’écriture. Ce que disent les manuscrits (A. Grésillon et M. Werner eds.), Paris, Minard, 1985.
11 « Traces », p. 154, voir aussi G. Baraclough, « Scientific method and the work of the historian » in Logic, Methodology and Philosophy of Science, Proceedings of the 1960 International Congress, Stanford University Press, 1962.
12 Cf. Paul Veyne, « La science […] est la connaissance qui s'applique à des "modèles de série », tandis que l'explication historique traite, cas par cas, des "prototypes" », « Foucault révolutionne l'histoire » (in Comment on écrit l'histoire, suivi de Foucault révolutionne l'histoire, Paris, Seuil, 1979.), p. 232‑233.
13 Il arrive aux généticiens de dire qu’ils cherchent à mettre en évidence des régularités dans les processus d’écriture, mais ils ne peuvent espérer y parvenir que de façon marginale et seconde. Leur premier souci est (au contraire ?) de relever des indices qui ne peuvent être que des irrégularités par rapport à un continuum.
14 Paul Veyne note aussi que « l’histoire est connaissance par traces » Comment on écrit l'histoire..., p. 103.
15 Nous nous séparons sur ce point de Michael Werner (tel qu’il s’exprimait en 1985, voir ci‑dessus note 10), qui suggèrait que la génétique, à l’exemple des formes les plus récentes de l’historiographie, devrait se débarrasser de sa forme narrative. Il semble douteux que l’histoire puisse jamais cesser d’être un récit (Paul Veyne affirme que l'explication historique « ne se distingue guère du genre d'explication qu'on pratique dans la vie de tous les jours ou dans n'importe quel roman où l'on raconte cette vie ; elle n'est que la clarté qui émane d'un récit suffisamment documenté ; elle s'offre d'elle‑même à l'historien dans la narration et n'est pas une opération distincte de celle‑ci, pas plus qu'elle ne l'est pour un romancier. Tout ce qu'on raconte est compréhensible puisqu'on peut le raconter. » Comment on écrit l'histoire, p. 69), mais en tout cas la forme narrative est inhérente à une discipline qui a pour objet les processus d’écriture. Ce qui ne veut pas dire que l’on doive nécessairement continuer à utiliser les formes narratives qui sont celles des romanciers du dix‑neuvième siècle, ni surtout que cette narrativité implique nécessairement, comme l’affirme Michael Werner, une croyance dans « le caractère unique et incomparable de l’événement » (« Genèse et histoire », p. 281).
16 Voir Umberto Eco, A Theory of Semiotics, Bloomington, Indiana University Press, 1979, p. 191‑217. Il propose de remplacer la notion de signe iconique (fondée sur la similitude) par celle de signe produit par ratio difficilis, c’est‑à‑dire en modelant directement la forme sur le contenu, sans l’intermédiaire d’un type expressif préformé (p. 183 et aussi Sémiotique et théorie du langage, Paris, PUF, 1993, p. 52‑54). Cette notion est particulièrement appropriée à la génétique, nous y reviendrons en conclusion.
17 Deux exemples spectaculaires de dissemblance sont cités dans « Les commencements du commencement »(Genèses du roman contemporain : Incipit et entrée en écriture, B. Boie et D. Ferrer eds, collection « Textes et Manuscrits », Éditions du CNRS, 1993), p. 16.
18 À condition d’admettre qu’il ne s’agit pas toujours d’une ressemblance directe, mais d’un rapport se matérialisant à travers un certain nombre de règles de projections, plus ou moins complexes. Ainsi, pour s’en tenir à un exemple d’une grossière simplicité, un manuscrit surchargé indique une genèse laborieuse, et plus il est surchargé, plus la genèse a été laborieuse — mais un manuscrit limpide ne prouve pas nécessairement un engendrement fluide.
19 Voir Robert Melançon : « Le statut de l’œuvre : sur une limite de la génétique », Études françaises 28.1, automne 1992.
20 Voir par exemple cette profession de Valéry : « reporter l’art que l’on met dans l’œuvre, à la fabrication de l’œuvre. Considérer la composition même comme le principal, ou la traiter comme œuvre, comme danse, comme escrime, comme construction d’actes et d’attentes.
Faire un poème est un poème. Résoudre un problème est un jeu ordonné. Le hasard, l’incertitude y sont des pièces définies. L’impuissance de l’esprit, ses arrêts, ses angoisses ne sont pas des surprises, et des pertes indéfinies.
Mais le faire comme principal, et telle chose faite comme accessoire, voilà mon idée. » (1922. R VIII, 578) Ego scriptor et Petits poèmes abstraits, Présentation et Choix de J. Robinson‑Valéry, Paris, Gallimard, 1992, p.171.
21 A Theory of Semiotics, p. 303.
22 L’actualité récente (1996) permet d’illustrer la charge d’irrationnel et même de magie qui s’attache aux empreintes. En effet, on a signalé en Australie un important vol d’empreintes de dinosaures. Il faut tout d’abord noter que le vol de cette relique immatérielle (puisqu’il ne s’agit que de quelques creux) a impliqué le déplacement de blocs de roche de plusieurs centaines de kilos. Ce vol a consterné les paléontologues — qui devaient pourtant les avoir moulés depuis longtemps et qui devaient donc en avoir tiré toute l’information possible. Il est vrai qu’on pourrait soutenir que les empreintes sont aussi irreproductibles que les œuvres d’art autographiques le sont d’après Nelson Goodman (voir Langages de l’art, Troisième partie: « Art et authenticité », Nîmes, Éditions Jacqueline Chambon, 1990), puisqu’on ne sait pas quels en sont les traits décisifs et donc ce qu’il importe exactement de reproduire. Le vol a aussi suscité la fureur des aborigènes, terrifiés à l’idée que ce vol pourrait déclencher des représailles de la part des grands animaux disparus, mais néanmoins présents à travers ces traces. Du même coup il a provoqué la vive préoccupation des administrateurs responsables des aborigènes qui craignent un soulèvement...
23 Roland Barthes par Roland Barthes, Paris, Seuil, 1975, p. 70.
24 Ceci est évidemment une simplification, ne serait‑ce que parce que les indices peuvent être simulés. On peut même considérer que dans l’énonciation, la « simulation » est inévitable et indiscernable.
25 Voir Roger Pierrot, « Un pionnier des études génétiques: le vicomte de Lovenjoul et les Paysans de Balzac », Genesis 5, 1994.
26 Voir J. Derrida, « Les morts de Roland Barthes », Psyché, Inventions de l’autre, Paris, Galilée, 1987, p. 299.
27 La génétique s’est très tôt intéressée à l’écrivain comme lecteur de son propre manuscrit dans le temps même de son écriture. Voir J.‑L. Lebrave, « Lecture et analyse des brouillons », Langages, n° 69, « Manuscrits‑Écriture, Production‑linguistique », mars 1983.
28 E. H. Gombrich, « The Evidence of Images » in Interpretation: Theory and Practice, ed. Charles Singleton (Baltimore, The Johns Hopkins Press, 1969), p. 68.
29 (1922. U VIII, 912) Ego scriptor..., p. 172.
30 Un peu comme on peut se demander en quel sens le Lucien de Rubempré du Père Goriot est le même que celui de Splendeurs et misères des courtisanes, le Marlow du Cœur des ténèbres celui de Lord Jim, le Stephen Dedalus de Portrait de l’artiste celui d’Ulysse, ou, question plus difficile encore, si le Quentin Compson du Bruit et la Fureur peut être le même que celui d’Absalon, Absalon!
31 Voir D. Ferrer, « "Practise preaching”: variantes pragmatiques et prédication suspendue dans un manuscrit des “Sirènes” » in D. Ferrer et C. Jacquet eds., Writing its own Runes for ever-Essais de génétique joycienne/ Essays in Joycean Genetics, Tusson, Du Lérot, 1998.
32 Il est curieux de constater que la génétique se trouve sur ce point confrontée à une difficulté du même ordre que celle que rencontrait la philologie classique, qui reposait sur deux principes contradictoires (même s’ils ne semblent pas avoir été ressentis comme tels par les philologues eux‑mêmes) : l’usus scribendi, qui veut qu’on se fonde sur les habitudes du scripteur pour entériner ou non une variante,et la lectio difficilior, qui veut que de deux leçons, on choisisse la moins prévisible.
33 Ce n’est cependant pas toujours le cas. L’article de Lacan sur « Le temps logique et l’assertion de certitude anticipée » (Écrits, Paris, Seuil, 1966) montre par exemple qu’un traitement de la subjectivité en termes absolument non‑psychologiques, et même purement formels, peut s’articuler avec une conception freudienne de la division du sujet.
34 Richard Ellmann, James Joyce, Oxford University Press, 1982, p. 110.
35 Pour une mise au point récente, voir Ruth Ronnen, Possible Worlds in Literary Theory, Cambridge 1994 et aussi le numéro de la revue Style intitulé « From Possible Worlds to Virtual Realities: Approaches to Postmodernism » (Vol. 29 2, été 1995). En français on peut consulter Thomas Pavel, Univers de la fiction, Paris, Seuil, 1988 et Umberto Eco, Lector in Fabula ou la Coopération interprétative dans les textes narratifs, Paris, Grasset, 1985
36 La notion de « monde possible » permet de résoudre dans un cadre extensionnel un certain nombre de problèmes liés à l’intensionnalité.
37 Ou encore « roman complets ». Un des problèmes qui se posent toutefois est précisément que les avant‑textes, par nature, sont incomplets, et qu’ils n’ont pas le statut de livres.
38 Plans et scénarios de Madame Bovary, Yvan Leclerc ed., Paris, CNRS Éditions / Zulma, 1995, p. 5 (f°3 r°).
39 Il s’agit en fait d’un aspect du problème de l’identification en droit de différentes versions comme versions de la même œuvre. Pour la formulation de ce problème et l’ébauche d’une solution, voir D. Ferrer, « La toque de Clementis : rétroaction et rémanence dans les processus génétiques », Genesis n° 6, 1994, p.98‑100.
40 Voyage en Égypte, P.‑M. de Biasi ed., Paris, Grasset, p. 145.
41 Plans et scénarios de Madame Bovary, p. 1 (f°1 r°).
42 « Charles Bovary officier de santé 33 ans quand commence le livre... »,Plans et scénarios de Madame Bovary, p. 1 (f°1 r°).
43 « Notes et brouillons », traduction de D. Ergaz, in F. Dostoievski, Crime et Châtiment, Bibliothèque de la Pléiade, Paris, NRF, 1960, p. 617‑618.
44 Paul Veyne, Comment on écrit l'histoire..., p.78‑79.
45 Jean Bellemin‑Noël, « Reproduire le manuscrit... », p. 7
46 Voir sur ce point D. Ferrer, « La toque de Clementis... », p. 96‑98.
47 Régis par un ratio difficilis, voir ci‑dessus note 16.
48 Même si le résultat est traditionnel, banal, redondant, stéréotypé...

















