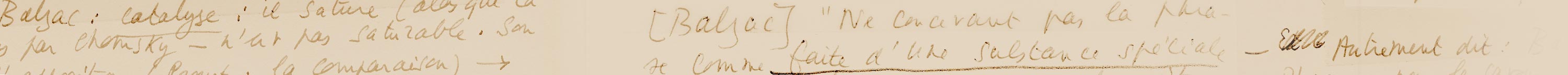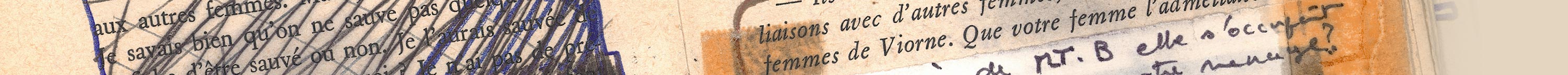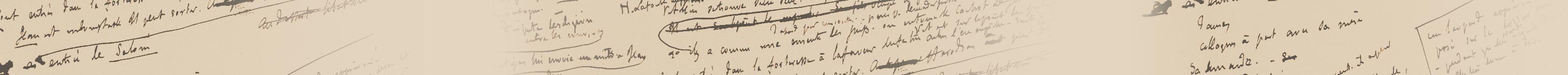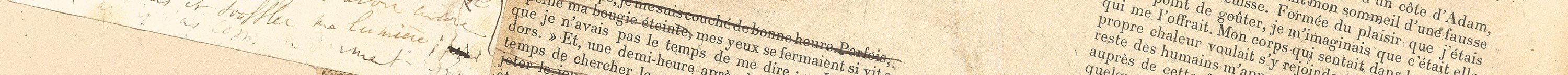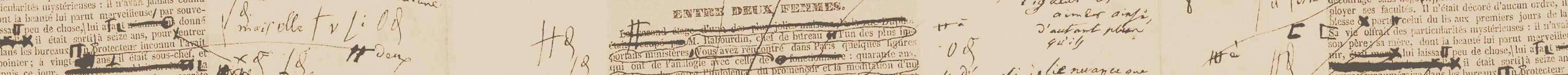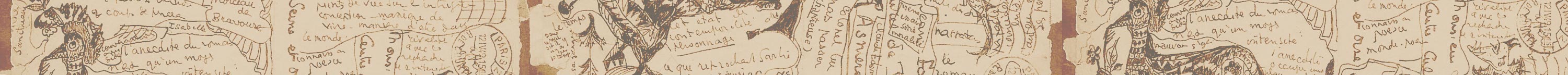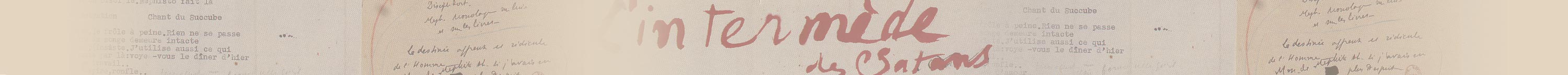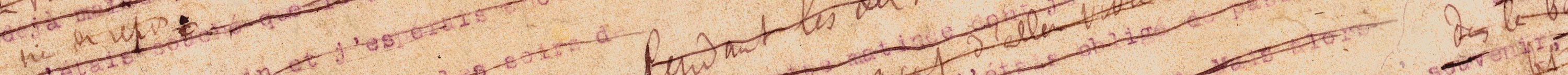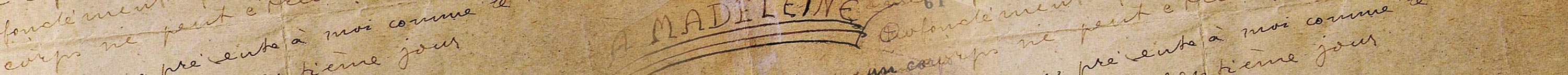CERCEC (CNRS/EHSS) ITEM
Docteure en histoire de l’art (Université Paris 1) et chercheuse associée au Centre d’études russes, caucasiennes, est-européennes et centrasiatiques (CERCEC, CNRS/EHESS) et à l’ITEM, Juliette Milbach enseigne l’art et la critique d’art de la première moitié du XXe sc à l’Université de Picardie Jules Verne (UFR Art).
Elle a étudié l’histoire de l’art et les sciences du langage à l’Université Paris 4, et le russe à l’INALCO. Dans le cadre d’un échange universitaire à Kazan (Tatarstan, Russie), elle s’est formée à la littérature russe, ainsi qu’à la culture et à la langue tatar. Parallèlement à la poursuite de ses études à l’Université Paris 1 sous la direction d’Eric Darragon, elle a passé trois années à Moscou au service culturel de l’Ambassade de France auprès de Blanche Grinbaum-Salgas, puis dans les archives pour son travail de thèse (soutenu en 2014).
Ancienne Visiting Fellow à l’institut Harriman (Université de Columbia, New York), à l’Institut des études avancées (UCL, Londres) et à l’Institut Warburg (Université de Londres) ses recherches examinent les circulations artistiques entre l’Union soviétique, l’Europe et les États-Unis et la construction des récits en histoire de l’art. L’intérêt porté aux sources archivistiques, né dans le contexte bien particulier et très formateur des archives russes, a dû être repensé après février 2022 et l’arrêt des séjours de recherche à Moscou. D’autres terrains, en particulier les archives américaines, ont permis de continuer l’exploration de la culture visuelle et les propos sur l’art soviétique à partir de nouveaux points de vue.
Depuis un premier travail sur un fonds privé à Moscou concernant le peintre Arkadii Plastov (1893-1972), la question de l’articulation des parcours individuels au récit plus global de l’histoire de l’art est une pierre angulaire dans sa réflexion. C’est dans cette perspective qu’elle a été lauréate de la Bourse « Collection École des Modernités » de l’Institut Giacometti en 2024 qui lui a permis de travailler sur le fonds Louis Lozowick (1892-1973) aux Archives de l’art américain (AAA, Smithsonian). L’ouvrage issu de cette recherche est à paraître au printemps 2026. Elle poursuit cette réflexion en tant que chercheuse associée au département des Arts du spectacle de la BNF sur le « Fonds Nina Brodsky : graphiste, scénographe, décoratrice et poète » pour l’année 2025-2026.
Nina Brodsky (1892-1979) comme Louis Lozowick est l’un des individus composant un corpus d’artistes partis des marges de l’Empire russe, principalement de la zone de résidence à laquelle les populations juives étaient assignée. Ces exils ont lieu au cours des deux premières décennies du XXe siècle pour des raisons politiques, économiques ou en conséquence aux répressions et persécutions. La cohérence du corpus tient non pas tant au terreau de naissance qu’à la direction de leur parcours. Ainsi, déjà formés comme artistes, ils viennent expérimenter des formes artistiques diverses dans les grands centres de la modernité artistique que sont Berlin, Paris et New York. Ce projet de recherche interroge la matérialité des fonds personnels, en se concentrant notamment sur les processus de collecte d’archives d’artistes en situation d’exil : le soin que ces artistes ont eux-mêmes porté à réunir, classer et conserver leurs archives apparaît d’autant plus éloquent dans la perspective contemporaine des nouveaux exils.
Depuis 2017, membre de l’Association pour les études slaves, est-européennes et eurasiennes (ASEEES), elle a organisé quatre sessions (panels) au congrès annuel en collaboration avec Angelina Lucento (Duke University) et Pierre-Louis Six (ENS).
Entre 2016 et 2022, elle a co-animé le séminaire mensuel « Cultures visuelles : Histoire croisée du regard soviétique » à l’INHA. En 2025, elle a été co-organisatrice du séminaire « Reconfigurations du champ de l’art après le 24 février 2022 Ukraine-Russie » à l’INHA avec le soutien de Thalim, de l’INHA, de la FMSH, du GDR-est.
Publications récentes :
- « Mémoire picturale à Moscou après 1950 : la trace et le témoignage », Revue des études slaves, T. 96, dir. par Nadia Podzemskaïa, « Artistes en Russie à la période soviétique. Voies oubliées de la modernité (1920-1950) », 2025, 1-2, p. 37-53.
- « (Ré)-Inventer l’artiste nihiliste pour mieux lutter contre lui : récit d’une proposition manquée (1929-1930) », dans Slavica Occitania, N°60, « Le nihilisme russe. Perspectives croisées : littérature, art, histoire des idées », dir. par Ioulia Podoroga et Tatiana Drobot, 2025, p. 245-264.
- « L’interprétation du motif du chantier dans la peinture (Moscou, années 1950-60) », Revue Transversale / histoire architecture urbain paysage, n°8, dir. Gilles-Antoine Langlois, Marie Gaimard, Léonore Dubois-Losserand « Chantiers – matière & outils : l’architecture mise en œuvre », 2024, 52-65.
Séminaire décrire la création 2025-26 :