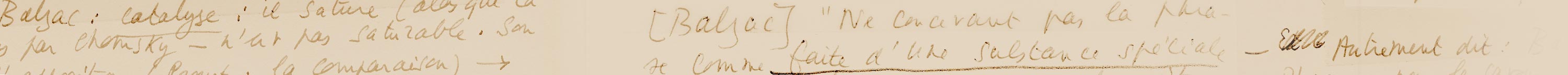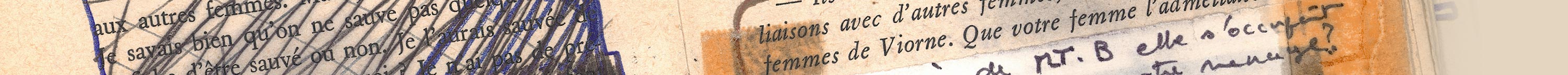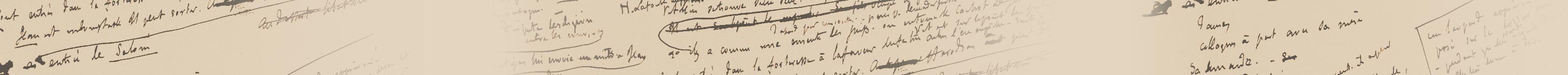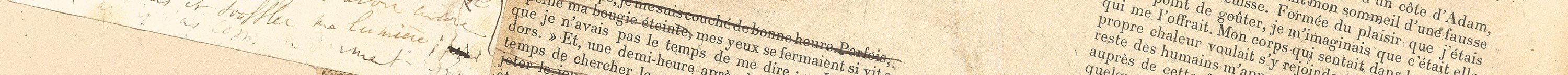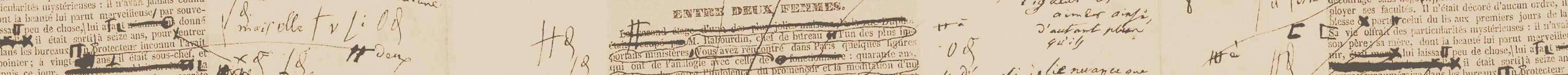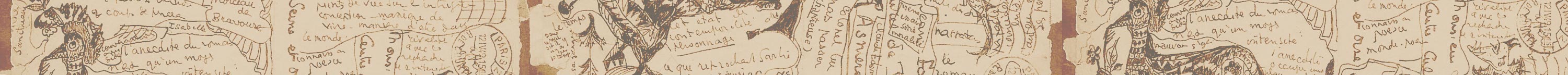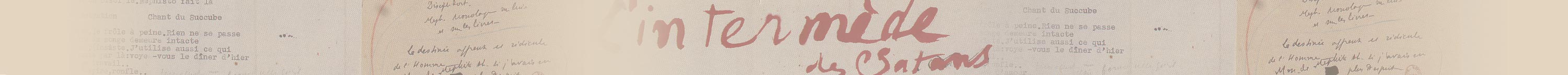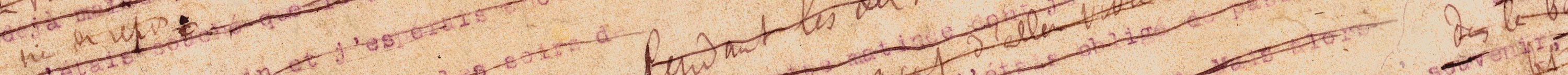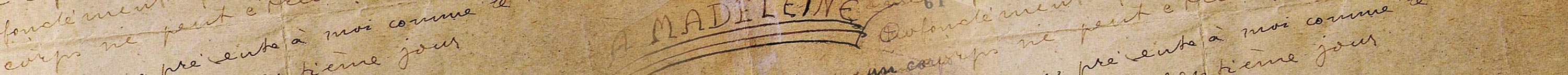Séminaire :
Homo fabulator, la performativité des fabulations / 2025-202612/03/2026, ENS, 45 rue d’Ulm, 75005 Paris – Salle de réunion Pasteur (14h-16h)
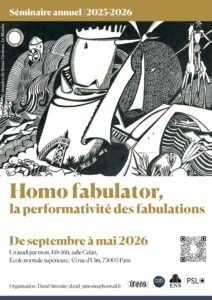 Rhétorique, réalité, métaphore : sur quelques enjeux de la métaphorologie de Blumenberg et de sa théorie de l’animal symbolicum (Jean-Claude Monod)
Rhétorique, réalité, métaphore : sur quelques enjeux de la métaphorologie de Blumenberg et de sa théorie de l’animal symbolicum (Jean-Claude Monod)
Résumé à venir.
La vérité de la métaphore, ou le point de rupture entre Ricœur et Derrida au sujet de Heidegger (Tristan Barberousse)
La dispute entre P. Ricoeur et J. Derrida au sujet de la métaphore se noue en particulier autour du sens à donner à la métaphore chez Heidegger. La question de la « vérité » de la métaphore exhibe leur différence. Elle permet de cerner leurs positions respectives, aussi bien de l’un par rapport à l’autre que de chacun d’entre eux par rapport à Heidegger.
À la fin de la VIIe étude de La métaphore vive, P. Ricoeur interroge : « Peut-on créer des métaphores sans y croire et sans croire que, d’une certaine façon, cela est ? » (La Métaphore vive, Le Seuil, 1975, p. 319). Il préfigure alors tout le problème de la VIIIe étude, où il reconnaîtra explicitement adopter un « accent heideggérien » au moment de défendre son concept de « vérité métaphorique ». Et pour cause, il pensera la vérité métaphorique sur le mode de la manifestation plutôt que de l’adéquation, afin de frayer une voie moyenne entre la « naïveté ontologique » et la « démytologisation ».
Dans « Le retrait de la métaphore », J. Derrida conteste la lecture par P. Ricoeur de son texte précédent sur la métaphore, « La Mythologie blanche », selon laquelle il n’aurait « tenté qu’une extension ou une radicalisation continue du mouvement heideggerien » (« Le Retrait de la métaphore » (1978), repris dans Psyché. Inventions de l’autre, t. I, Galilée, 1987, p. 69). En réponse, J. Derrida déconstruit la philosophie de Heidegger en doublant le constat premier de la situation « époquale » du concept de métaphore (en tant que produit de la métaphysique) par le constat second de l’impossibilité de la saisie de l’histoire de l’être sans métaphore. Finalement, la vérité de l’être ne saurait se dire que par une « métaphore de métaphore ».
Tristan Barberousse est normalien, agrégé de philosophie et doctorant en philosophie esthétique sous la direction de Jean-Claude Monod (UMR 8547, ED540) à l’ENS Ulm depuis 2024. Il travaille sur la dispute qui opposa P. Ricoeur et J. Derrida au cours des années 1970 à propos de la place de la métaphore en philosophie. Sa perspective est l’image en tant que critère de distinction aussi riche que problématique entre le concept et la métaphore. Il organise un séminaire en collaboration avec Zoé Grange-Marczak, « Avant/Après Derrida », dont le thème sera cette année « Lectures de Derrida ». Il donne par ailleurs cours en Master à l’ENS, en collaboration avec Giuseppe Al Majali, et un cours en Licence 3 en CPES.
Jean-Claude Monod est philosophe, chargé de recherche aux Archives Husserl (« Pays germaniques », UMR 8547, CNRS), spécialiste de philosophie allemande contemporaine (notamment de Hans Blumenberg) et de philosophie politique. Il est notamment l’auteur de Sécularisation et laïcité (PUF, 2007), Qu’est-ce qu’un chef en démocratie ? Politiques du charisme (Seuil, 2012), L’Art de ne pas être trop gouverné (Seuil, 2019) et a dirigé le Dictionnaire Claude Lévi-Strauss (Bouquins, 2022).