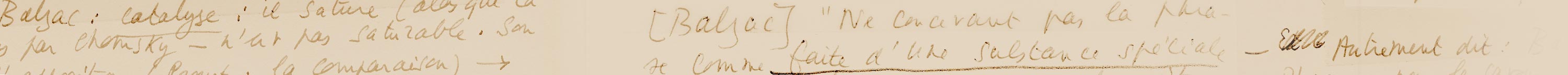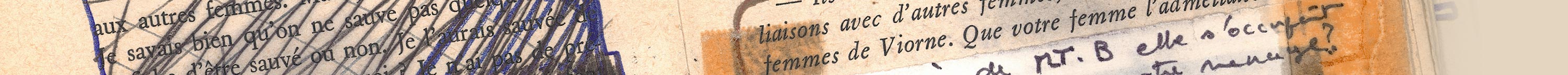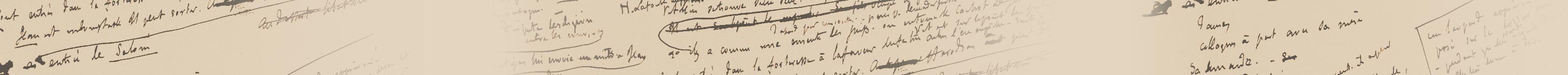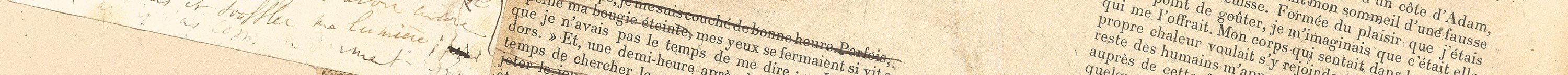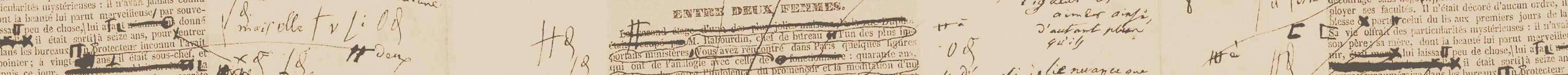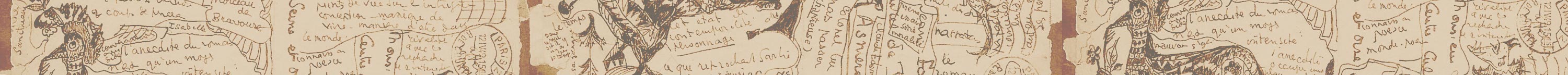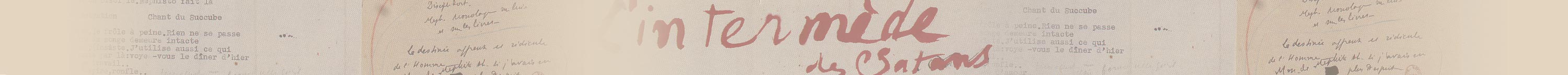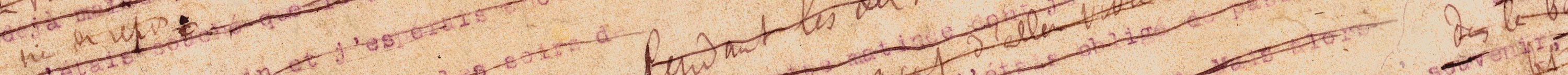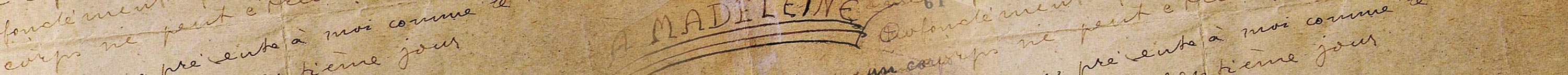Séminaire :
Homo fabulator, la performativité des fabulations / 2025-202611/12/2025, ENS, 45 rue d’Ulm, 75005 Paris – Salle de réunion Pasteur (14h-16h)
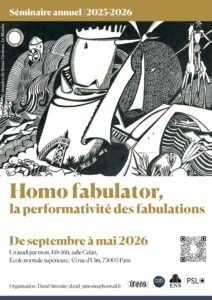 Dans cette contribution, j’aborde le débat sur l’Allemagne secrète entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle. L’« Allemagne secrète » peut être définie comme un topos littéraire, un phénomène à l’origine éminemment littéraire, qui se développe au sein du cercle d’intellectuels autour de Stefan George. Ce topos littéraire mobilise cependant une série d’éléments déjà présents depuis longtemps dans l’imaginaire culturel de l’Allemagne de la fin du XIXe siècle et est à son tour interprété par les différentes instances culturelles du début du siècle comme un outil herméneutique, critique et comme un véritable agent culturel. En tant que mythe moderne, l’Allemagne secrète se charge rapidement de significations qui dépassent la dimension purement fictive et même esthétique, et aspire à une validité plus large, tant dans le domaine historique que social et politique, de la culture et de la Weltanschauung allemandes. Dans cette contribution, je tenterai de définir les limites conceptuelles de ce que j’ai appelé la « théologie négative » de l’Allemagne secrète, en m’appuyant sur les orientations méthodologiques d’un auteur comme Furio Jesi et en retraçant certaines étapes du développement de ce mythe : de Paul de Lagarde à Ernst Kantorowicz, en passant par Gaston Choisy.
Dans cette contribution, j’aborde le débat sur l’Allemagne secrète entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle. L’« Allemagne secrète » peut être définie comme un topos littéraire, un phénomène à l’origine éminemment littéraire, qui se développe au sein du cercle d’intellectuels autour de Stefan George. Ce topos littéraire mobilise cependant une série d’éléments déjà présents depuis longtemps dans l’imaginaire culturel de l’Allemagne de la fin du XIXe siècle et est à son tour interprété par les différentes instances culturelles du début du siècle comme un outil herméneutique, critique et comme un véritable agent culturel. En tant que mythe moderne, l’Allemagne secrète se charge rapidement de significations qui dépassent la dimension purement fictive et même esthétique, et aspire à une validité plus large, tant dans le domaine historique que social et politique, de la culture et de la Weltanschauung allemandes. Dans cette contribution, je tenterai de définir les limites conceptuelles de ce que j’ai appelé la « théologie négative » de l’Allemagne secrète, en m’appuyant sur les orientations méthodologiques d’un auteur comme Furio Jesi et en retraçant certaines étapes du développement de ce mythe : de Paul de Lagarde à Ernst Kantorowicz, en passant par Gaston Choisy.
Carlotta Santini (Chargée de Recherche CNRS/ENS). Mes recherches portent en particulier sur l’Allemagne du XIXe siècle, dont j’étudie les développements culturels et les relations entre les disciplines scientifiques, avec une approche éminemment philosophique et d’histoire des idées. Philosophe de formation, je suis spécialiste de l’œuvre et de la pensée de Friedrich Nietzsche. Je suis membre du Vorstand de la Nietzsche Gesellschaft et je compte parmi les responsables de l’édition de la Philologica de Friedrich Nietzsche pour les éditions Adelphi (Milan) et Les Belles Lettres (Paris). Parallèlement à mes intérêts nietzschéens, je mène des recherches plus ciblées sur l’histoire des études classiques dans l’Allemagne du XIXe siècle et sur la réception de l’Antiquité et des modèles classiques dans la culture allemande, dans les domaines les plus divers : de l’anthropologie (Leo Frobenius) à la géographie (Friedrich Ratzel), en passant par l’histoire de l’art (Aby Warburg) et l’histoire culturelle (Jacob Burckhardt). Je mène actuellement un projet de recherche sur la naissance de la pensée mythologique en Allemagne entre le 18e et le 20e siècle. Je m’intéresse particulièrement à l’émergence de la mythologie en tant que science historique dans le cadre de la philologie classique traditionnelle, à l’introduction de la méthode philologique et historico-critique aux mythologies « autres », européennes et extra-européennes, et à l’analyse des constructions mythiques et idéologiques dans le contexte historico-politique de la fin du XIXe et des premières décennies du XXe siècle.