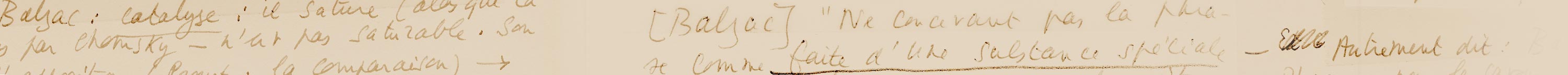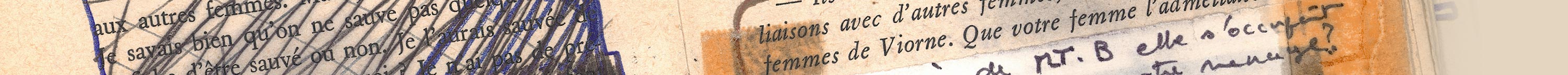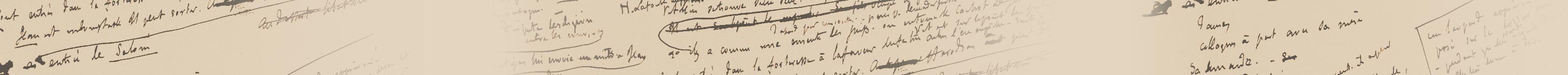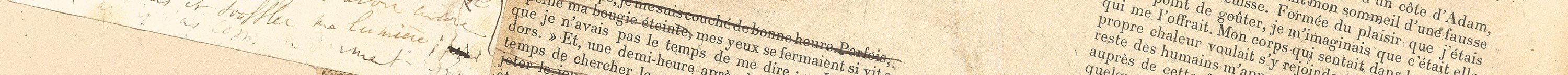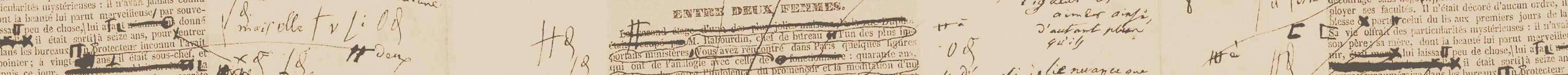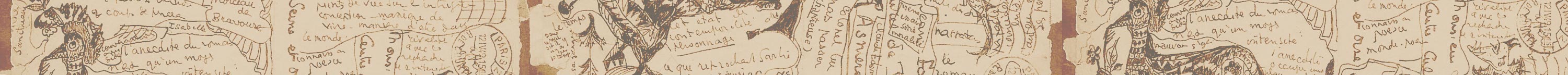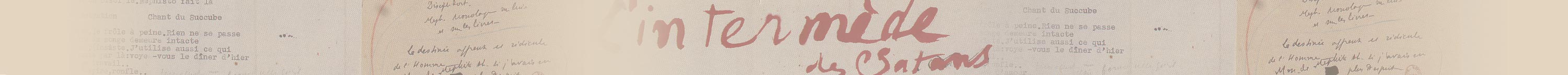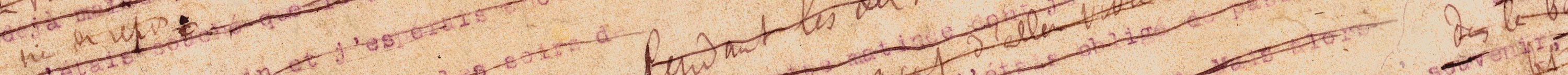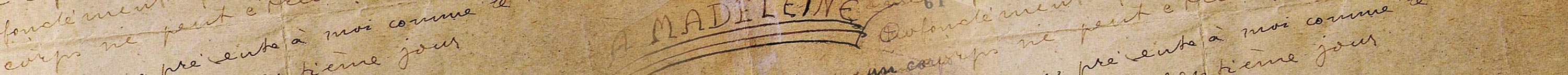L’objectif du groupe « Génétique XVI-XVII » est d’interroger les conditions de possibilité d’une étude de la genèse des écrits des XVIe et XVIIe siècles en prenant en considération les spécificités du régime textuel qui caractérise les productions de la première modernité : de la composition manuscrite d’un unique auteur aux diverses formes d’écriture à plusieurs mains, de la réappropriation des passeurs de textes que sont les secrétaires, traducteurs, compilateurs, commentateurs, illustrateurs, imprimeurs-libraires, aux nouveaux états manuscrits, parfois émanant des auteurs premiers, qu’occasionnent ces manipulations textuelles, etc.
Le séminaire de « Génétique éditoriale de la première modernité », codirigé de 2016 à 2019 à l’ITEM par Anne Réach-Ngô et Richard Walter, a interrogé ces enjeux théoriques et méthodologiques, en mettant l’accent sur les modalités de publication de ces corpus. La réflexion théorique, nourrie de présentations de projets en cours, s’est accompagnée d’un atelier pratique d’édition numérique sur le site Joyeuses Inventions, où sont encore aujourd’hui expérimentés les différents outils à disposition pour restituer la singularité des modes de production, de circulation et de diffusion des recueils poétiques collectifs de la deuxième partie du XVIe siècle.
Les travaux de Guillaume Peureux, consacrés à l’exploration de la production poétique entre 1570 et la fin du XVIIe siècle, prennent également pour objet l’étude des processus collaboratifs de création, mais aussi des modes de diffusion et de réemploi des textes qui les soumettent à une importante variabilité pour laquelle s’impose une approche généticienne. De telles perspectives soulèvent la question du statut du texte littéraire de la première modernité et de sa reconfiguration rétrospective à travers le prisme des définitions modernes de l’auctorialité et de la paternité littéraire. Un numéro de la revue Littérales, « Dossiers génétiques de la première modernité » (n. 47, 2021), ainsi qu’un ouvrage, De Main en main. Poètes, poèmes et lecteurs au XVIIe siècle (Hermann, 2020), s’inscrivent dans ces réflexions.
Outre les différents travaux produits par les membres de l’équipe, celle-ci prépare un ouvrage collectif à vocations théorique et méthodologique qui sera achevé à l’automne 2024. Proposant de nombreux cas d’étude et un travail minutieux de conceptualisation, ce livre rend compte des activités de l’équipe depuis 2018 autour des méthodes d’analyse propres à des objets textuels des XVIe et XVIIe siècles. En traitant des limites de l’enquête généticienne, il incite à poser un regard nouveau sur l’auctorialité de la première modernité et sur la variabilité des œuvres. Il engage notamment, dans la constitution des dossiers génétiques, à récuser le primat de l’indice auctorial et, pour ce qui est des versions du texte, la primauté du manuscrit sur l’imprimé et celle de l’autographe sur l’allographe. Il ouvre enfin des perspectives sur l’édition critique.
À la parution de ce travail, l’équipe organisera un colloque international. Il s’agira, en s’appuyant sur les propositions faites dans le livre, de discuter nos hypothèses avec une communauté élargie de chercheurs travaillant sur nos périodes et de les confronter aux approches développées par les généticiens travaillant sur des périodes plus récentes.